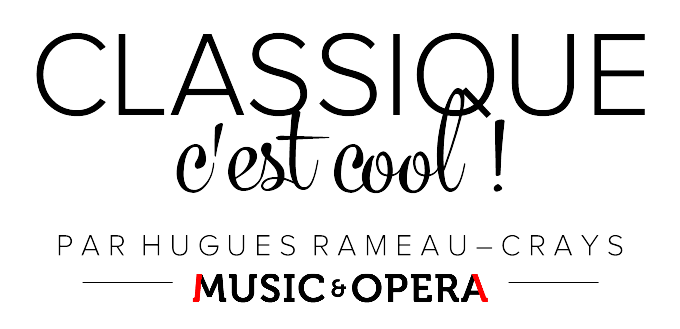A Comique, le conte n’y est pas pour Hoffmann
Après une longue absence, Les Contes d’Hoffmann retrouve l’Opéra-Comique où le chef-d’œuvre d’Offenbach a été créé. Avec une nouvelle mise en scène et des nouveaux dialogues parlés, les mélomanes impatients ont-ils été contents des Contes ? Réponse…
Carmen, Lakmé, Pelléas et Melisande sont tous nés à l’Opéra-Comique comme Hoffmann. Alors que les opéras de Bizet, Debussy et Delibes ont souvent été repris salle Favart, Les Contes d’Hoffmann d’Offenbach n’a pas eu cette chance. Après trente ans d’absence, le dixième titre le plus joué à Comique est revenu à la maison dans une production de Lotte De Beer, créée la saison dernière à l’Opéra du Rhin. Ce 29 septembre 2025, avec une distribution renouvelée, l’attrait du spectacle était également de découvrir la version établie par le chef d’orchestre Pierre Dumoussaud d’après la plus complète des éditions critiques (celle de Jean-Christophe Keck). Le chef-d’œuvre du petit Mozart des Champs- Élysées étant un vrai terrain de jeu pour les musicologues, chaque interprétation est une découverte. Cependant avec l’introduction de nombreux dialogues parlés réécrits par Peter te Nuyl, Les Contes d’Hoffmann n’ont pas semblé bons.
Sans diables, Peter te Nuyl met de l’huile sur le feu
Lorsqu’en 1851, Michel Carré et Jules Barbier, alors jeune duo de librettistes, se sont intéressés aux nouvelles d’E.T.A. Hoffmann, ils ne se doutaient sans doute pas que presque 200 ans plus tard, leur travail serait encore discuté. Il faut dire que leur livret et la partition d’Offenbach sont passés entre plusieurs mains dont celles de Léon Carvalho. Le puissant directeur de l'Opéra-Comique de l’époque, connu pour son « interventionnisme », n’a pas épargné Offenbach, mort avant la première des Contes d’Hoffmann. Plusieurs airs ayant été coupés, replacés et certains maintenant perdus, on ne saura jamais vraiment les intentions du compositeur, ce qui laisse libre cours à la fantaisie. Pour sa production, Lotte De Beer ne s’est pas embarrassée de ces considérations musicologiques pour déconstruire l’ouvrage en s’appuyant sans finesse sur de nouveaux dialogues écrits par Peter te Nuyl. Recadrées, les histoires sont racontées du point de vue du personnage de La muse qui offre au passage une psychanalyse sauvage à Hoffmann, héros déjà bien malmené. Les relectures sont toujours bienvenues dès lors qu’elles prennent sens sans dénaturer comme lorsque Christof Loy a fait de Werther un petit mâle toxique, avec intelligence. La dernière image d’un Hoffmann qui se bat avec son double puis qui lui tombe dans les bras en pleurs est censée nous faire comprendre qu’il ne peut pas être aimé des femmes parce que le seul sentiment qu’il éprouve, c’est l’amour de lui-même. Pourquoi pas ! Mais faire passer le personnage pour un érotomane se satisfaisant avec sa muse dans ses écrits tourne assez court et surtout, nous prive de toute émotion. Le fantastique abandonné, les décors de Christof Hetzer sont au mieux, sinistres, au pire, glauques et certaines scènes, gratuites, frisent le malsain comme lorsque le serviteur Fritz se frotte à Antonia dans sa scène (« c’est la méthode ») qui est habituellement un moment de comédie. Le seul intérêt de cette production est la mise en avant du personnage de La muse et Nicklausse qui trouve une place de démiurge commentant et intervenant sur les aventures. Malheureusement, les apartés et un rideau qui coupe sans arrêt les scènes perturbent l’attention et l’on sort avec le sentiment d’un spectacle vain. À côté d’un fort Niklausse et d’un Hoffmann minable, aucun personnage n’existe. Les quatre vilains relégués au second plan sont cocasses mais n’effraient jamais quant aux héroïnes, sans chair, elles ne sont que des prétextes.
Sur le papier et dans les faits, on n’y trouve pas ses Contes !
Plutôt abonné aux succès, l’Opéra-Comique est très souvent loué pour ses distributions impeccables. Sur le papier, Michael Spyres, doté de suraigus brillants et d’une technique impressionnante, était un Hoffmann idéal. Peu aidé par un costume qui ne l’avantage pas, le ténor est une étonnante déception. Même si le timbre est toujours aussi beau, Spyres ne trouve jamais le ton juste pour faire exister son personnage vocalement (à sa décharge, la metteuse en scène qui gomme toute flamboyance ne l’a pas aidé). Alors qu’il aborde des rôles wagnériens plus lourds, il paraît beaucoup trop empesé pour que l’on se souvienne de sa prestation. Jean-Sébastien Bou est un acteur chanteur de grand talent, toujours constant mais qui semble trouver ici sa limite vocale. Le baryton manque cruellement de graves pour les quatre rôles de vilain (Lindorf/Coppélius/Miracle/Dapertutto) et ne parvient jamais, lui non plus, à incarner ses personnages. « Tu cherches le diable partout » répète souvent Héloïse Mas dans le double rôle de La muse et de Nicklausse, le spectateur également ! Elle est la seule à parvenir à habiter la scène avec sa voix bien placée de mezzo joliment timbrée et un abattage qui conquiert le public. Ses airs sont les plus remarqués même si « Vois sous l'archet frémissant » et « Des cendres de ton cœur » pourraient gagner à être encore plus enlevés. On sait gré à Pierre Dumoussaud d’avoir rétabli des airs souvent absents et d’avoir osé la suppression d’un tube comme « Scintille, diamant ! » mais que de lourdeurs dans sa direction ! Alors qu’il est l’un des chefs les plus brillants de sa génération, il appuie le théâtre et perd au passage la subtilité et l’élégance d’Offenbach pourtant bien présente dans la partition. Peu de sopranos ont abordé les quatre rôles féminins et les réussites se comptent sur les doigts d’une main. Dès les premières notes d’Olympia avec des aigus coincés, on comprend qu’Amina Edris n’est pas capable de relever le défi. Lorsque l’on connaît l’engagement et le travail accompli, il est bien détestable de critiquer un artiste mais malheureusement ici, il n’y a rien à sauver tant elle est dépassée par les difficultés de ses partitions. Dans les rôles secondaires, Matthieu Justine tire brillamment son épingle du jeu en incarnant les rôles de Nathanaël, Spalanzani et Le Capitaine des sbires. Avec une belle aisance vocale, ce jeune ténor construit intelligemment sa carrière en se plaçant comme un évident talent à suivre de près. On l’a dit, la scène plombée de Frantz empêche Raphaël Brémard, ténor de caractère, à apporter de la légèreté d’autant plus qu’il force sur les décibels sans raison. Il peut prendre exemple sur Nicolas Cavallier (Luther et Crespel) et Sylvie Brunet-Grupposo (La voix de la mère) toujours parfaits. Les membres du chœur Aedes préparé par Mathieu Romano comme les musiciens de l’Orchestre philharmonique de Strasbourg connaissent également leur métier et méritent des éloges dans ce flot de déceptions. Les muses n’étant pas constamment inspirées, l’Opéra-Comique comme ses spectateurs fidèles méritent d’autres Contes d’Hoffmann qui marqueront l’histoire de cette belle maison. On le souhaite de tout cœur !