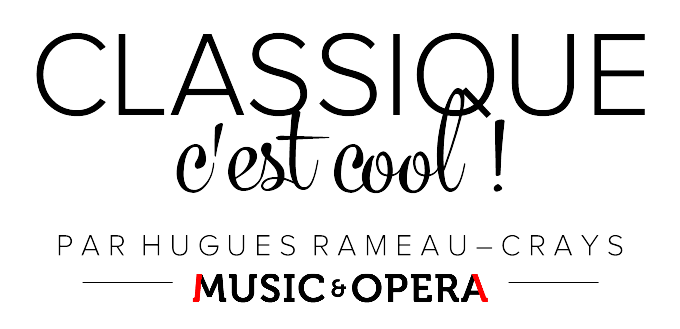Walkyrie déconnectée cherche la flamme à l’Opéra Bastille
Monter une nouvelle production de la Tétralogie de Wagner avec ses quatre opéras relève toujours de la gageure. Après un démarrage difficile, l’Opéra national de Paris propose un deuxième rendez-vous qui ne calmera pas la colère des dieux. Explications…
Deuxième volet de la Tétralogie de Richard Wagner, Die Walküre était à l’affiche de l’Opéra Bastille ce 18 novembre 2025. La troisième représentation de la nouvelle production de Calixto Bieito a été accueillie dans un calme relatif malgré les débats que sa mise en scène peut susciter. L’homme de théâtre a, en effet, une réputation de provocateur et pour une œuvre-monstre telle que Der Ring des Nibelungen (confiée à la baguette experte de Pablo Heras-Casado), était-il la personne rêvée pour donner vie à l'œuvre d'art totale voulue par le compositeur ? Cadeau empoisonné (?), la production intégrale, décidée par le prédécesseur de l’actuel directeur de l’Opéra national de Paris, Alexander Neef, sera reprise en 2026, année anniversaire de la création à Bayreuth.
Siegmund s’arrache les tripes tandis qu’E-doggy is watching you !
Il reste encore deux productions (Siegfried est attendu en janvier 2026, Götterdämmerung un peu plus tard, tandis que le Ring complet sera donné en novembre 2026) avant de voir Calixto Bieito confronter le public de l’Opéra Bastille, le metteur en scène ayant décidé de ne venir saluer qu’au dernier spectacle de la Tétralogie. Les quatre épisodes forment un tout et cette décision est légitime. Il est cependant à parier que les « antis », encore plus remontés, hurleront leur désapprobation plus fort tandis que les « pros » apporteront, sans nul doute, la balance en s’époumonant avec leurs bravos. C’est que la mise en scène présente un cas d’école. De nombreuses difficultés attendent les artistes qui osent s’affronter au chef-d’œuvre de Wagner avec ses scènes de bataille dignes de Game of Thrones et d’autres scènes de la vie conjugale, tout aussi tendues. Calixto Bieito ne suit pas le texte à la lettre, il en a le droit, mais il escamote à peu près tous les moments difficiles attendus. Le héros Siegmund, supposé sortir une épée d’un frêne, s’arrache le ventre et la dégaine du sol (ou de son bidon, la scène n’est pas très claire) tandis que Brünnhilde, la fameuse walkyrie coiffée de son casque ailé dans les images d’Épinal, arrive sur scène, non pas sur son fier destrier, mais sur un bâton de cheval comme une enfant. Ces éléments de scène ressemblent plus à des pieds de nez qu’à une relecture intelligente de l’opéra. Bieito souligne l’immaturité de Brünnhilde qui grandira bientôt, confrontée à ses choix. À plusieurs reprises, elle brandit un poignard vers papa Wotan, pour « tuer le père », on l’a bien compris. Les mélomanes assistent à un patchwork de scènes parfois bien vues (Sieglinde en femme battue, Brünnhilde vraie guerrière), souvent ridicules (la Walkyrie balance Siegmund à travers la pièce comme dans un jeu vidéo) dans un décor métallique de data center qui évoque l’Académie des Neuf ou un calendrier de l’Avent. Une note de programme nous renseigne sur l’intention du metteur en scène qui fait évoluer ses personnages dans « un monde dystopique dominé par le numérique et les réalités virtuelles ». La traduction de son concept, peu lisible, atteint son point culminant lors de la fameuse chevauchée des Walkyries où les images de la salle que filme E-doggy, le « chien-robot Evotech » sont projetées en grand. On y découvre les spectateurs de Bastille en robots formatés. La provocation tombe à plat, les cerveaux encore disponibles refusant de se prêter à ce jeu de controverse, trop facile.
Hojotoho ! Nous avons une grande Brünnhilde sur scène
Même s’il convient peut-être d’attendre le tout dernier épisode pour comprendre le message du metteur en scène, les personnages ont du mal à exister dans ce fatras. C’est le cas de celui de Sieglinde, pourtant assez bien développé au premier acte mais ensuite réduit à se tordre de douleur sous l’effet des contractions. Pliée en deux, Elza van den Heever envoie ses puissants aigus avant de quitter pauvrement la scène. Admirée en Salomé (en 2022, sur cette même scène), la soprano peine à convaincre pleinement dans ce rôle où la voix, lorsqu’elle est placée en retrait, marque de curieuses différences d’émission. Même s’il s’éclate la panse, Stanislas de Barbeyrac est un Siegmund crédible alors qu’il n’a pas grand-chose à jouer, les scènes de l’acte I se déroulant principalement en hauteur, dans le cadre réduit d’une petite pièce. Vocalement, le ténor français qui ne cesse d’évoluer relève aisément les défis de ce rôle. Bien des péripéties ont déjà miné les représentations de Das Rheingold, le baryton distribué en Wotan ayant été remplacé par trois autres chanteurs. Rebelote avec Die Walküre, Christopher Maltman a assuré les premières représentations (avec panache, apparemment) tandis que James Rutherford a tenu le rôle avec des moyens plus modestes. Souvent couvert par l’orchestre, il a néanmoins sauvé la représentation en se fondant facilement dans le décor post-apocalyptique. En Hunding, Günther Groissböck a plus de mal avec le registre aigu désormais privé de vibrato, tandis qu’Ève-Maud Hubeaux s’impose facilement en Fricka grâce à son mezzo riche et une belle ligne de chant. Dans un costume strict bleu qui rappelle la Serena Joy de La Servante écarlate, l’artiste arrive à rester crédible dans son numéro de dominatrice à qui il ne manquerait qu’une cravache. La tenue des Walkyries, transformées en grenouilles 2.0, pose problème pour reconnaître les interprètes, toutes excellentes. Même si elle apparaît à califourchon sur son bâton à tête de cheval, Tamara Wilson réussit son entrée sur scène en poussant un « Hojotoho » digne des plus grandes Brünnhilde. Impressionnante de bout en bout, elle domine d’une tête l’ensemble de la distribution jusqu’à la scène finale où elle retrouve douceur et fragilité dans de superbes nuances. Reste la direction de Pablo Heras-Casado, admirable dans les passages doux où la musique se fait caresse. Il n’insuffle pas toujours le théâtre qui aurait pu sauver quelques scènes malgré la belle implication de l’Orchestre de l’Opéra national de Paris. À l’impossible, nul n’est tenu !